Ambiance as a key issue in the contemporary Mediterranean public space
International Conference
February 24-26th, 2014,  Tunis Science City, Tunis, Tunisia
Tunis Science City, Tunis, Tunisia
 Tunis Science City, Tunis, Tunisia
Tunis Science City, Tunis, Tunisia
$FB_HTML(html)$
L’ambiance comme enjeu de l’espace public méditerranéen contemporainA partir du cas de la Tunisie — miniature mais dense — cette conférence internationale interroge la possibilité du partage dans les espaces publics contemporains en Méditerranée. Elle questionne le rôle joué par l’architecture et les formes de l’urbain dans la possibilité même du partage et invite à réfléchir sur les formes et les ambiances à venir, dans un contexte d’hyper-pluralité où la notion de voisinage se trouve remise en cause, et celle de marquage plus que jamais à ré-explorer. Depuis la chute du régime Benaliste advenue le 14 janvier 2011, on assiste en Tunisie et plus précisément dans l’espace public à ce qui pourrait être non pas un « retour de l’habitant » mais une « arrivée de l’habitant ». Les Tunisiens aujourd’hui « habitent » l’espace public, l’espace commun, l’espace en partage. Après avoir détruit ou significativement altéré les édifices qui symbolisaient la dictature (villas et biens des proches du pouvoir, commissariats et divers bâtiments administratifs), ils s’approprient les lieux en taguant les murs et en investissant les places et les avenues par des sit-in plus ou moins longs ou des marches de contestation. Mais au-delà de cette (ré)appropriation visible que l’on pourrait qualifier de « révolutionnaire », existe-t-il une réappropriation moins visible qui prendrait la forme d’une critique plus ou moins consciente de l’espace public désormais interrogé à l’aune de sa dimension d’espace en partage ? Cette question fera l’objet d’une série de manifestations et de rencontres sur les ambiances de l’espace public méditerranéen contemporain. Une première conférence initiée par l’ERA/ENAU (Equipe de Recherche sur les Ambiances de l’Ecole Nationale d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis), se déroulera à Tunis, à la Cité des Sciences, les 24, 25 et 26 février 2014. Inscrite dans le cadre des séminaires et conférences annuels du Réseau International Ambiances, elle aura pour objet d’asseoir la problématique et de lancer un réseau méditerranéen de travail autour de ces questions. | Ambiance as a key issue in the contemporary Mediterranean public spaceTaking Tunisia — a tiny yet dense country — as a case study, this international conference addresses the possibility of sharing contemporary public spaces in the Mediterranean. It addresses the role played by architecture and urban forms in the sharing process itself and also invites to think of future forms and ambiences in a context of hyper-plurality in which the notion of neighborhood is put into question and the notion of space marking is more than ever re-explored. Since the fall of Ben Ali’s regime on January 14th 2011, Tunisia and precisely its public spaces have witnessed what cannot be called a “return of the inhabitant” but rather an “arrival of the inhabitant”. Tunisians today live in the public space, the common space, the shared space. After destroying or significantly altering the relics which symbolized dictatorship (villas and properties of people close to the regime, police stations and various administrative buildings), people are appropriating the public areas by spraying graffiti on the walls and invading squares and avenues through more or less long sit-ins and protest demonstrations. But beyond this obvious re-appropriation, that can be considered “revolutionary”, is there a less visible re-appropriation under a more or less conscience criticism of the public space, henceforth measured relatively to the shared space? This question will be treated in a series of demonstrations and meetings on the ambiences of contemporary Mediterranean public spaces. A first conference initiated by the ERA/ENAU (Research Team on the Ambiences of the National School of Architecture and Urbanism of Tunis) will be held on the 24, 25 and 26 February, 2014 at the Tunis Science City. Organized in the framework of the annual seminars and conferences of the International Ambiances Network, it will aim at setting the problematic and at launching a Mediterranean work network on these questions. |
| Conférence proposée et organisée par Olfa Meziou et Alia Ben Ayed. Avec le soutien de :
Information :  olfa.meziou2014@gmail.com olfa.meziou2014@gmail.com | Conference proposed and organized by Olfa Meziou and Alia Ben Ayed. With the support of:
Information:  olfa.meziou2014@gmail.com olfa.meziou2014@gmail.com |
| |
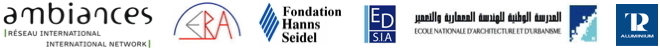
| |
La révolution, un révélateur...« Maintenant, au contraire, on est chez soi. Mais le chez-soi ne préexiste pas… » 1 La chute de la dictature Benaliste a révélé une Tunisie fragmentée. Les identités s’y heurtent, les modèles sociétaux s’y télescopent, les disparités socio-économiques y sont plus visibles que jamais. On y découvre qu’un peuple partageant quelques 163 610 km2 (c’est le plus petit pays du Maghreb), une histoire commune et un même climat géographique est un peuple hétéroclite aux aspirations opposées et parfois contradictoires et qui, sommé de manifester sa perception d’un même réel étant donné la situation extrêmement politisée (parce que les règles à venir se jouent maintenant), confirme son extrême pluralité. Cette arrivée de l’Habitant (avec un grand H parce qu’il est tous les habitants) pluriel, à la fois soudaine et intense, nous a conduits à nous interroger sur la question de la possibilité de l’habitabilité plurielle de l’espace public tunisien, c’est-à-dire de son partage. Ce partage est-il possible ? L’espace public tunisien dans ses formes actuelles (conformation et formes sensibles) est-il propice au partage ? Porte-t-il les traces d’une dictature qui a aménagé d’ « en haut », relayée par des architectes eux-mêmes assez sourds aux questions du partage et de la chose publique ? La Tunisie, une Méditerranée en miniature...C’est à partir de la situation à la fois miniature et dense de la Tunisie que nous souhaitons explorer la question des ambiances méditerranéennes. En effet, la situation tunisienne montre la désuétude de la notion classique de voisinage. Nous partageons un même territoire mais il n’y a pas/plus cette « contamination mimétique grâce à laquelle un modus vivendi, une manière de dessiner et de s'assurer l'espace vital se propage dans une population »2 et qui, selon P. Sloterdijk, caractérise les voisins. Mais la question du voisinage se pose dans chaque pays de la Méditerranée et à l’échelle de la Méditerranée comme lieu supposé de voisinage. La situation tunisienne montre que la perception collective du réel n’est pas / n’est plus structurée par le seul lieu (une même histoire, une même géographie, un même climat) mais aussi par un monde virtuel aux réseaux très différenciés. Mais cette situation n’est pas propre à la Tunisie ; elle est mondiale. Face à cette hyper-pluralité que l’on pourrait qualifier d’endogène (elle ne vient plus de l’étranger qui ne s’attend pas à trouver de la familiarité dans le pays où il arrive mais touche ce qu’on pourrait appeler les autochtones), quelles formes donner à l’espace public forcément unique et local ? Que faire pour qu’il puisse contenir tous les marquages, cette ritournelle nécessaire qu’évoquent Deleuze et Guattari : « Maintenant, au contraire, on est chez soi. Mais le chez-soi ne préexiste pas : il a fallu tracer un cercle autour du centre fragile et incertain, organiser un espace limité. Beaucoup de composantes très diverses interviennent, repères et marques de toutes sortes. (…) Voilà que les forces du chaos sont tenues à l'extérieur autant qu'il est possible, et l'espace intérieur protège les forces germinatives d'une tâche à remplir, d'une œuvre à faire. Il y a là toute une activité de sélection, d'élimination, d'extraction, pour que les forces intimes terrestres, les forces intérieures de la terre, ne soient pas submergées, qu'elles puissent résister, ou même qu'elles puissent emprunter quelque chose au chaos à travers le filtre ou le crible de l'espace tracé. »3 Si l’ « endogénéité » de l’hyper-pluralité caractérise plus les pays de la rive sud de la Méditerranée, l’hyper-pluralité, elle, touche également les pays de la rive nord attirant depuis de nombreuses années des populations d’émigrés. A plus ou moins long terme, ces pays pourraient bien avoir aussi à s’interroger sur l’impact des formes des espaces publics sur le sentiment du partage et les possibilités d’un vivre-ensemble harmonieux de populations forcément métissées. La Tunisie, miniature… ou tesselle ?Chaque pays de la Méditerranée a sa propre histoire et sa propre histoire de l’architecture et de l’urbanisme, son propre climat géographique et son propre climat politique. Chaque pays de la Méditerranée a aussi ses propres nouvelles « unités de voisinage » si l’on peut qualifier ainsi ces groupes nationaux porteurs de perceptions communes et de stratégies analogues alimentées à la fois par les lieux et les réseaux. Les questions que soulève la Tunisie sont celles de l’espace public en général et la situation politique ne fait en réalité que les mettre au jour, comme surexposées. L’espace public contemporain en Méditerranée — espace politique et scénique — pose la question du partage et par conséquent celles du voisinage, de l’étrangéité, de la familiarité, de la porosité et de l’accessibilité. L’étude des situations en Libye et en Egypte, proches du point de vue de la situation politique actuelle et différentes du point de vue de l’histoire, ou de celles du Maroc et de l’Algérie qui n’ont pas connu les révolutions arabes et ont adopté des politiques patrimoniales différentes, permettront d’ébaucher les contours des réponses. Les études et réflexions portant sur les pays de la rive nord de la méditerranée permettront d’identifier les différences et les similitudes qui existent entre les deux rives et de savoir s’il est possible de penser des stratégies communes pour tendre vers une harmonie dans des sociétés hyper-plurielles. Repenser l’espace publicCette réflexion nous a menés vers les interrogations suivantes :
| The revolution, a revealer...« Now, on the contrary, we are at home. But home does not preexist…»1 The fall of Ben Ali’s dictatorship lifted the veil on a divided and fragmented Tunisia where identities collide, social models crash into each other and socioeconomic disparities are more than ever exposed. The Tunisians, sharing a territory of 163 610 km2 (Tunisia is the smallest North African country), a common history and a same geographical climate, are a heteroclite population with opposite and sometimes contradictory aspirations, and confronted to demonstrating their perception of a common reality given the extremely politicized situation (because future rules are in effect now) they confirm Tunisia’s extreme plurality. This intense and abrupt arrival of Inhabitants (all inhabitants) led us to wonder about the plural habitability of the Tunisian public space, i.e. how can it be shared? Can the Tunisian public space, in its current forms (sensitive conformation and forms), be shared? Does it still hold any remnants of the dictatorship demands that were taken over by architects who in turn were not sensitive enough to public spaces concerns? Tunisia, a miniature of the Mediterranean...Starting from Tunisia’s both miniature and dense situation, we intend to explore the Mediterranean ambiences. In fact, the Tunisian situation reveals the obsolescence of classical notion of the neighborhood. We are sharing the same territory but there is not/no more that “mimetic contagion through which a modus vivendi, a way to draw and to ensure that the vital space spreads among a population”2 and which, according to P. Sloterdijk, characterizes neighbors. But the question concerning neighborhood is raised in each Mediterranean country and at the Mediterranean level as a supposed neighborhood place. The Tunisian situation demonstrates that the collective perception of reality is not / no more structured by the only one place (same history, geography and climate) but also by a virtual world of different networks. But this situation is not proper to Tunisia’s case, it is a worldwide feature. Considering this endogenous hyper-plurality (which no more affects a foreigner who does not expect to feel at ease in the country he/she visits, but also affects whom we may call endogenous), which shapes should be given to the public space, necessarily unique and local? What should be done so that it contains all the necessary markings, that same thing again and again mentioned by Deleuze and Guattari: “Now, on the contrary, we are at home. But home does not preexist: it was necessary to draw a circle around that fragile and uncertain center, to organize a limited space. Many and very diverse components intervene, landmarks and marks of all kinds. (…) The forces of chaos are kept outside as much as possible, and the interior space protects the calendar forces of a task to fulfill or a deed to do. This involves an activity of selection, elimination and extraction, in order to prevent the earth interior forces from being submerged, to enable them to resist or even to take something from chaos across the filter or sieve of the drawn space.”3 If the hyper-plurality’s “endogeneity” characterizes more the countries located on the southern of the Mediterranean, it does also affect the countries on the north shore attracting for a good number of years multiple immigrant populations. In a less or more long term, these countries may have to deal with the impact of public space forms on the feeling of sharing and the possibility of living in a harmonious side by side of obviously mixed race populations. Tunisia, a miniature... or a tessera?Each Mediterranean country has also its own history including its own architectural and urban planning history along with its own geographical and political climate. Each country has also its own “neighborhood units” what we can call these national groups who hold common perceptions and similar strategies derived from both places and networks. The questions raised by our country concern mainly the public space and are accentuated in reality by the current political situation as overexposed. The contemporary Mediterranean public space — a political and scenic space — raises the issue of the notion of sharing, in consequence leading to the notion of neighborhood, alienation, familiarity, porosity and accessibility. The studies on Libya and Egypt’s, close to their present political situations, and different from the historical point of view, or of Morocco and Algeria’s situations, countries that didn’t witness Arab revolutions, and which adopted different patrimonial policies, will serve into drafting the responses’ major outlines. The studies and thoughts on the countries north of the Mediterranean will allow us to identify the differences and similarities existing between both shores and to consider the possibility of building common strategies towards harmonious hyper-plural societies. Rethink the public spaceThis reflection led us to various interrogations:
|
| NOTES 1. Gilles Deleuze & Félix Guattari, Mille plateaux (11 – 1837, De la ritournelle), Paris, Les éditions de Minuit, 1980, 648p. 2. P. Sloterdijk, Sphères III. Écumes. Sphérologie plurielle, traduit de l'allemand par Olivier Mannoni, Paris, M. Sell, 2005. p.229-230. 3. Gilles Deleuze & Félix Guattari, op. cit. 4. Jacques Ferrier, La Possibilité d’une ville. Les cinq sens et l’architecture, Paris, arléa, 2012, 130 p. | |
| |
Responsables scientifiques | Scientific officers
Comité scientifique | Scientific Committee
Conférenciers et discutants invités | Guest Speakers and Discussants
Comité d’organisation | Organizing Committee
|
| |
Accueil des participantsLa conférence se tiendra à la  Cité des Sciences de Tunis les 24, 25 et 26 février 2014. Cité des Sciences de Tunis les 24, 25 et 26 février 2014.L’inscription sera gratuite et les repas des communicants, pendant la conférence, seront pris en charge par les organisateurs. | Welcome of the participantsThe Conference will be held at the  Tunis Science City on the 24th, 25th and 26th of February 2014. Tunis Science City on the 24th, 25th and 26th of February 2014.Registration will be free and the organizers will cover the meals of speakers during the conference. |
Lundi 24 février | Monday February 24th
| 2 pm | Enregistrement des participants | Registration of participants |
| 2:30 - 3 pm | Ouverture de la conférence | Opening of the conference Présentation du Réseau International Ambiances, de l'ENAU et de l’ERA. Mot du Directeur de l’école doctorale ED-SIA. |
| 3 - 4 pm | Conférence d'ouverture | Inaugural conference
|
| 4 - 4:30 pm | Pause | Break |
| 4:30 - 6:10 pm | Session #1 — Concepts et théorie | Concepts and Theory Président de session | Chair: Jean-Paul Thibaud
|
| 7 - 8 pm | Diner | Dinner |
| 8:30 - 10:30 pm | Soirée projection et débat cinématographique | Cinematographic projection and discussion Présentée et animée par | Presented and facilitated by Nicolas Tixier Avec Mahmoud Ismaïl (Egypte) et Hichem Ben Ammar (Tunisie) | With Mahmoud Ismaïl (Egypt) and Hichem Ben Ammar (Tunisia) |
Mardi 25 février | Tuesday February 25th
| 9 - 10 am | Conférence invitée | Invited conference
|
| 10 - 10:30 am | Pause | Break |
| 10:30 - 12:10 am | Session #2 — Ville au quotidien | Daily City Life Président de session | Chair: Jean-Pierre Péneau
|
| 12:30 am - 2 pm | Déjeuner | Lunch |
| 2:20 - 4 pm | Session #3 — Art, culture et espace public | Art, Culture and Public Space Présidente de session | Chair: Alia Ben Ayed
|
| 4 - 4:30 pm | Pause | Break |
| 4:30 - 6:10 pm | Session #4 — Moments révolutionnaires | Revolutionary Moments Président de session | Chair: Daniel Siret
|
| From 7:30 pm | Diner de gala | Social dinner |
Mercredi 26 février | Wednesday February 26th
| 9 - 10:30 am | Session de présentation des posters | Posters exhibition and discussion Présidente de session | Chair: Hind Karoui
|
| 10:30 - 11 am | Pause | Break |
| 11 - 12:15 am | Synthèse et discussion | Synthesis and discussion Présentée et animée par | Presented and facilitated by Olfa Meziou Avec les discutants invités | With the guest discussants: Pascal Amphoux, Azeddine Belakehal, Nadir Boumaza |
| 12:15 - 12:30 am | Clôture de la conférence | Closing of the conference |
| 1 - 2:30 pm | Déjeuner dans la médina | Lunch in the medina |
| 3 - 7 pm | Visite de la ville | Tour of the city De la place du 14 janvier (début de l’avenue Habib Bourguiba) à la place de la Kasbah (extrémité Est de la médina). |
Suivre un fil de ville en ville, par Alissone Perdrix
![]()
Suivre un fil de villes en villes, celui d’un récit fait d’images et de mots, depuis Tunis, Alger, Fès, Jerusalem... Ce récit a pris la forme d’un texte lu, accompagné d’une projection de photographies, et d’extraits vidéos.
Le texte retranscrit par une description sensible les ambiances traversées, et ce depuis ma propre posture, variable et multiple, à la fois de touriste, d’étrangère, de femme et de cinéaste. C’est tout à la fois la question de l’observation, de la mobilisation des sens mais également la position du cinéaste et de l’oeil prédominant dans l’expérience filmique qui fabriquent le récit. En filigrane se construit un ensemble de questions non résolues au regard des situations vécues et à l’aune d’une expérience intense de l’espace public de ces territoires. Il y a là une volonté de parler « depuis » ou « avec » ces lieux plutôt que « sur ».
Se pose alors la question de l’accueil du corps filmant, de son devenir dans l’espace public. Mais aussi comment filmer ? Quelle légitimité ? Quels points de vue ? Quels cadres ? Quels stratagèmes imaginer pour assumer une place aussi exposée, inconfortable, parfois même impossible dans l’espace public. D’autres questions surgissent également concernant le devenir public des images rapportées. Comment rendre compte de l’enquête, de la captation du vif ? A l’instar d’un récit touristique, ces différentes problématiques émergent d’une forme d’intranquilité dans l’exploration. Elle transforme la quête en enquête ; celle-ci continue de hanter et d’alimenter le travail au fur et à mesure des immersions, de ville en ville.
Les images sont pensées dans une résonnance aux textes lus, non pas une illustration mais un prolongement et la possibilité de rentrer différemment dans les problématiques soulevées. Elles sont issues des explorations dont il est question dans le récit, mais ne sont ni situées géographiquement, ni synchronisées avec la prise de parole. Cela permet de créer un trouble entre récits et images, en questionnant directement les écarts et les similitudes de ce qui forme l’espace public du pourtour méditerranéen. A travers notament la persistance des formes architecturales, la posture des corps dans l’espace public, cet « être là »... Ou en alimentant les prises de positions développées dans le texte, à savoir la nécessité d’avoir recours à un intercesseur, le prisme par lequel filmer... Mais aussi le regard que nous construisons sur l’espace public et ce qui structure une perception commune. Où sommes nous ?
Ici ou ailleurs ?





